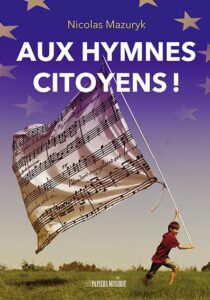La femme-serpent
Les amours démoniaques entre et un amant post-moderne imprudent et une « Mélusine » reptilienne, inspirée de la vierge aux jambes de serpent, ancêtre des Scythes. A travers ce croisement improbable, l’auteur semble nous emmener aux sources mythiques du matriarcat ukrainien…
Traduit de l’ukrainien par
Nicolas Mazuryk & Anna Khartchenko

1
Dès qu’arrivent les vacances, il faut toujours que je me mette à fuir quelque part. Fuir mon boulot, mon entourage, ma ville. Encore heureux que je n’aie pas fondé de famille : après quelques assauts féminins heureusement repoussés, quelque chose en moi s’est mis à rebuter les femmes, du moins en ai-je la nette impression. Tenez, dans le tram ou le trolley, quand une place est libre à côté de moi, ce n’est jamais la fille sortant de ses mues juvéniles ou n’importe quelle autre femme sexuellement active qui la prend, mais une babouchka ou une espèce de gros-Ivan. Je n’en fais pas grand cas et m’en réjouis même, car s’il y a bien une chose que j’aime et chérie dans la vie, c’est la liberté individuelle, — seule véritable valeur, semble-t-il. Par ailleurs, laisser une quelconque descendance ici-bas n’est pas dans mes ambitions. Un puritain me traiterait volontiers d’égoïste. C’est fort possible. Mais je suis intimement convaincu que ma démarche participe davantage de l’altruisme que de l’égoïsme, et ce pour une raison très simple : laisser venir au monde une quelconque descendance, est-ce bien raisonnable quand on sait que ce monde n’en finit pas de rouler dans l’abîme et qui sait si les gens arriveront un jour à stopper ce train d’enfer; et puis éviter de prendre femme, c’est éviter à ma moitié conjugale d’être malheureuse, étant moi-même impuissant à la rendre heureuse ; primo, parce qu’une femme c’est jamais content, donc jamais heureux ; secundo, parce que le bonheur, selon moi, ça n’existe pas, c’est là l’une des chimères les plus élémentaires de l’humanité et je ne suis pas assez idiot pour ne pas le comprendre. J’ai donc des principes dans la vie, principes que je tiens d’un certain philosophe ; lequel au juste, je ne saurais le dire, ayant un jour et par hasard entendu cette phrase :
« Si je ne puis faire quelque chose de bien en ce monde, au moins n’y ferais-je pas de mal. »1NDT et suivantes : fameuse maxime du penseur ukrainien Grégoire Skovoroda (deuxième moitié du XVIIIe s.) Il se trouve que l’auteur de cette nouvelle est un fin skovorodiste.
En son temps, cette pensée était tombée en moi comme une poignée de levure dans un pot de malt, faisant tout fermenter, tout pétiller ; tout en moi s’était mis à remuer, à bouillonner, encore que j’en sois parfaitement conscient : dresser tel ou tel principe est toujours plus aisé que de lui donner chair. Essayez donc de ne pas faire le mal, alors qu’il est partout et que le bien s’avère illusoire. Non, tout cela est bien trop compliqué pour ma petite tête, alors je ne me complique pas la vie : ne pas semer le mal ici-bas, c’est d’abord préserver la liberté individuelle, éviter les relations intimes, ne pas se rendre dépendant d’autrui et ne pas rendre autrui dépendant de soi. Je n’ai jamais pu trouver ni pu concevoir de voie plus vertueuse.
Du reste, les lecteurs de Valeriy Chevtchouk, que je connais personnellement, pourront aisément me reconnaître dans la deuxième partie de Duo sur berge, une nouvelle en diptyque dans laquelle je suis par trop grossièrement décrit.2En ukrainien Двоє на березі (Dvoyè na Berezi) publiée en 1984, dont le second volet ou antistrophe s’intitule « Une aventure hors du commun ». En ukrainien: Оказія не нащодень (Okazia ne nachtchodèn). Grossièrement ? Il faut dire que ce monsieur n’a jamais reçu mon aval pour me décrire, ou plutôt me décrier. Et si je n’ai jamais voulu faire d’esclandre à ce sujet, c’est encore une fois pour une raison très simple : juger qui que ce soit en ce monde n’est pas dans mes habitudes, ce serait aller à l’encontre du principe même de liberté individuelle dont j’ai fait ma devise ; en somme, chacun est libre de faire ce qui lui plaît du moment que cela ne cause de tort à personne ; dire en revanche que cette lecture fut pour moi d’un quelconque agrément serait parfaitement abusif. Mais puisqu’on y dévoile assez fidèlement mon entourage, inutile de le refaire ici ; les plus curieux pourront toujours se référer au volet en question, cette partie du diptyque étant tout à fait conforme et digne de foi. Ce pourrait être comme un préambule à mon histoire, préambule pour lequel je donne toute licence à Valeriy Chevtchouk, sans quoi le récit qui va suivre pourrait manquer de clarté.
2
J’ai donc sorti mon sac à dos, y ai glissé une petite tente monoplace et tout l’attirail qu’il me faut : petite hache, couteau, assiette en alu, cuillère, sel, anti-moustiques, anti-taons, patates, condiments pour la youchka (soupe de poisson), croûtons de pain — ces derniers séchés par mes soins avant mon départ —, quart, thé, sucre et enfin canne à lancer, canne à poser et une petite épuisette pour les appas (ces trois derniers portés à la force des poignets). J’y fourrai encore mon sac de couchage et montai ainsi chargé-plié dans le bus, direction les rives ombragées du Dnipr3Principal fleuve d’Ukraine, deux fois plus long que la Loire. Dnipro en ukrainien, Dniepr en russe. Jadis Danpar au temps des Ostrogoths, Dānapr (Rivière profonde) pour les Scythes ou Borysthène chez Hérodote. L’historien grec raconte à ce propos que la femme-serpent Echidna aurait conçu avec Héraclès le premier héros des Scythes : Scythès. Virgile quant à lui, évoque les amours entre Zeus et Hora, une nymphe mi-femme, mi-serpent. C’est en Scythie qu’elle enfanta Colaxès, roi des Thraces bisaltes, issus des Scythes royaux. Les bijoux gréco-scythes superposent souvent la Déesse serpentine et Cybèle. Au XIe s. encore, un talisman princier invoquait sa protection. et les étangs de Kontcha-Zaspa où j’avais mes habitudes, — alors me gagnait le sentiment d’apaisement qui me gagne toujours lorsque je suis sur le point d’accomplir cet acte délicieux d’évasion vers la sainte, comme je l’appelle, solitude.
Ça y est, ma petite tente est en place et je remue dans l’herbe comme jadis le héros d’Intermezzo, la nouvelle de Mékhaïlo Kotsyoubénskéï4Dans cette nouvelle, Michel Kotsioubynsky traite de la place de l’homme dans la nature, tel l’artiste dans la société. Il s’agit d’un des grands « classiques » de la prose courte ukrainienne.; à perte de vue, d’immenses solitudes, des herbes hautes et des cheveux-d’anges pliant sous la brise légère, des prairies en fleurs et de l’air frais gorgé de fragrances ; au-dessus de ma tête un ciel et un soleil radieux inondent ces lieux presque déserts, — c’est alors que naissent en moi de sourdes et timides béatitudes, je sens ce soleil et ce ciel s’épandre, non seulement sur les vertes étendues, mais en mon âme aussi, car tout ici me comble, m’exhausse et console.
D’humain par ici, il n’est que les pêcheurs accoutrés de leur uniforme (un truc quasi-militaire) encore que ces derniers soient cloués sur la berge au pied de leurs cannes, les yeux rivés sur le bouchon et sans autre occupation que de surveiller ledit bouchon en le tirant parfois d’un coup sec, — alors éclate par-dessus l’onde la robe argentée d’une belle touche. Il y a aussi les mouettes, majestueuses lorsqu’elles survolent ces eaux, et les alouettes qui gazouillent au-dessus de ma tête, tandis que résonne en moi leur petit timbre d’argent. Parfois une grue cendrée passant par-là comme tous les étés, traverse l’éther (sait-elle au moins qu’elle est une espèce menacée ?) — chose qui ne risque pas d’effrayer les corneilles, si nombreuses en ces lieux qu’une seule nuée suffit à couvrir la moitié des cieux. Il arrive aussi qu’au-dessus de moi, suspendu dans l’azur, plane un milan noir, compère de la grue par ses facultés d’adaptation — on le voit parfois se poser sur une branche morte à la cime d’un arbre, pour s’y tenir sombrement avec son bec crochu. Les arbres morts forment d’improbables et fantastiques sculptures, chefs-d’œuvre d’abstraction que j’aime à contempler tant me subjugue l’aléatoire réseau de leurs lignes et de leurs formes ; mais d’une manière générale, sentir qu’ici personne n’a besoin de moi et que je n’ai moi-même besoin de personne, m’agrée grandement.
Mais c’est pas le tout, l’heure du déjeuner approche et je deviens à mon tour un de ces pêcheurs cloués sur la berge les yeux rivés sur le bouchon, et lorsque ledit bouchon se met à piquer vers le fond, mon cœur sautille de joie, je remonte ma ligne et voilà qu’un joli poisson crispé d’effroi se tortille dans ma paume ; or comme tout pêcheur qui se respecte, je suis impitoyable, j’arrache donc ma victime à l’hameçon et la jette illico dans ma popote. Je ne pêche en revanche que le strict nécessaire, juste assez pour la youchka du midi et du soir, jamais davantage, autrement dit toujours selon mes besoins et dans les quantités prévues. C’est la loi qui règne en ces lieux et je m’y soumets, car à pêcher davantage il n’y aurait plus rien à pêcher.
L’eau du lac est si claire qu’on peut y voir le fond sablonneux dans lequel vagabonde l’encore étourdie et imprudente blanchaille ; j’en relâche le surplus resté dans ma boîte et tandis que le menu fretin s’éparpille joyeusement, je ramène au bivouac du bois sec, le fends, l’allume, cale ma popote, nettoie le poisson, les patates, et voilà que dans un paisible bloubloutement ma popote me mitonne ma youchka en laissant jaillir du tréfonds de ses entrailles, tantôt des morceaux de patate finement tranchée, tantôt la belle silhouette pâlie d’un poisson. Pendant ce temps, je trouve une petite bande de sable, m’adosse au front du rivage et abaisse enfin les paupières. C’est ici que je m’abandonne au soleil, en sentant venir ses caresses et baisers qu’aucune femme ne saurait prodiguer ; j’ai alors l’impression d’être à mon tour azur et diaphane, que ce ciel est ma propre tête où planent des oiseaux et s’élèvent parfois des mouettes au rire d’argent. À cet instant précis, je ne pense qu’au strict nécessaire qui en fin de compte se résume à peu de choses. Vraiment, les gens devraient vivre comme je vis ici : dans et avec la nature, en y puisant de temps à autre ce dont ils ont besoin, pas davantage ; s’abreuver du soleil et se donner à lui, les narines emplies des senteurs de l’herbage, de la flore et des eaux. Sottes pensées, me direz-vous, mais ô combien réjouissantes !
Je sens que ma youchka est prête, j’en puise une lichette, son sublime bouquet m’explose au nez. J’en verse alors la moitié dans un quart, y ajoute quelques croûtons et commence à manger, les mâchoires bien actives, en savourant non tant cette youchka que ce petit rituel.
Sur la rive d’en face, des pêcheurs se sont retrouvés au bord du lac, et comme à leur habitude, ils arrosent leurs exploits du jour en les mimant à qui mieux mieux, en écartant les bras, — très peu pour moi, je ne touche plus à la horilka5Horilka : nom de la vodka en ukrainien depuis un certain temps et leurs palabres, beaucoup trop primaires pour moi, ne présentent aucun intérêt. Au vrai, j’aurais préféré ne voir personne sur ces berges, mais où trouver à notre époque un endroit sans personne, vraiment personne ? C’est que les gens — ces drôles de petites bêtes — ont tellement pullulé ces derniers temps qu’on en voit arriver de partout, d’ailleurs il se trouve que je suis moi-même un de ces petits insectes. Par conséquent, où que j’aille, où que je sois, je n’échapperai jamais aux gens ; ce serait comme essayer d’échapper à moi-même, or à ce que je sache, on n’échappe pas à soi-même. Pour y remédier, j’ai un truc bien à moi : un petit coup de baguette et je me transforme en une sorte d’appareil-photo magique qui braque tout ce petit monde au téléobjectif, le doigt prêt au déclic, attentif, surattentif même, aux pêcheurs que je tiens là au bout du viseur, alors tel un chasseur s’apprêtant à faire feu, je presse la gâchette imaginaire : les pêcheurs s’effacent de ma vue, commencent à se dissoudre, ou plus exactement, à se désanimer, autrement passant à l’état d’objets ; et comme par enchantement, je me retrouve à nouveau seul sur ces berges, d’ailleurs que pourrions-nous avoir en commun, eux et moi ? Qu’ils vivent leur vie, confinés dans leurs propre espace et dimension, eux dans la leur et moi dans la mienne, ainsi finirais-je par devenir quelque chose de tout à fait inapparent à leurs yeux ; nous serions alors mutuellement invisibles, tel que peuvent l’être les arbres ou les plantes qui ne risquent pas d’irriter ni même être remarqués, puisqu’on les tient ici pour quelque chose allant de soi.
Mais il est d’autres fauteurs de troubles : les bronzés en bagnole. Par chance, ceux-là ne viennent jamais de mon côté et se cantonnent à la rive d’en face, encore qu’ils soient parfaitement visibles depuis l’endroit où je me trouve et que leurs jacasseries parviennent jusqu’à moi. C’est toujours le même topo : au début une bagnole déboule sur la berge, des portières s’ouvrent de chaque côté, puis comme dans un refrain sans fin, toute une troïka se met à débarquer : « lui, elle, le vieux, la vieille », la petite smala des moujikets et enfin le clébard qui selon les goûts de ses maîtres sera de la taille d’un chat ou d’un veau, mais qui petit ou gros déboulera sur la berge pour se dégourdir les pattes et pousser ses aboiements, petits ou gros.
Les bronzés pendant ce temps, mettrons leurs corps à l’air : la plupart du temps, gondolants, malbâtis, boutonneux, bedonnants, répugnants, à mon goût du moins , — comme si encore un de ces artistes contemporains les avait saisis au couteau ou au pinceau ; ça braille, ça beugle, ça s’éclabousse, ça fait ouïe, ça fait aïe, puis ça se met en rond et dans un bruit vulgaire de mastication (que j’imagine) ça boustifaille ; sur la nappe il y a des bouteilles, des thermos, des pots, des gamelles, — et quand tout ce petit monde a fini, ça ramasse les thermos, les gamelles, ça roule les pots, les bouteilles et les restes dans du papier journal ; ça balance tout sur place, ça part s’affaler sur la plage (les adultes, s’entend) puis ça reste inerte un long moment bras et jambes étendus, pendant que dans les ventres (désolé, encore mon imagination) ça bloubloute comme la youchka dans ma popote, tandis que les petits, autrement dit la ribambelle des moujikets, remuent dans tous les sens, hurlent à tue-tête, vont se baigner et défonce le sable, — parfois il en arrive plusieurs de bagnoles, et plusieurs groupes s’étalent sur la berge.
Je fais avec eux ce que je fais avec les pêcheurs : mes yeux se refusent à les voir, mes oreilles à les entendre, je suis donc à nouveau seul sur la berge et je me sens parfaitement bien, bercé de calme et de silence, sans autre bruit que le doux chuintement des feuillages, tandis qu’au loin s’offre à mon regard une vaste prairie où se tiennent toutes branches dehors, les plus basses touchant terre, de grands et beaux chênes solitaires ; à fleur d’eau, les saules ruissellent de lumière, tandis qu’à travers la plaine vagabondent muettement des ondes herbeuses vers un lointain bosquet de chênes. Alors je devine la longue course du temps, lente et sereine, qui ne s’écoule pas comme ces vagues, mais pénètre toute vie et tout être : chênes, herbes, saules, oiseaux, pêcheurs, bronzés et moi-même simple mortel ; elle nous ronge tous petit à petit, vouant par là-même notre existence à l’implacable néant.
Les seuls gagnants ici, ce sont les arbres, qui même morts vont durer sous la forme et l’aspect de sculptures abstraites, alors que nous autres, éphémères mochetés contemporaines ou abstraites au jour présent, finirons tous dans le néant comme un petit tas de bidoche fétide. Mais cela ne me chagrine pas outre mesure, car j’ai un autre souci : trouver mon équilibre spirituel et unir autant que faire se peut mon esprit à la grande paix céleste, autrement dit j’entre dans le rien avec mon esprit et c’est bien en cela que réside la véritable sérénité, — c’est ainsi que je me forge à mon retour en ville et le monde insensé des hommes, manège de faux-semblants.
3
Le soir venu, aux toutes premières lueurs du crépuscule, j’ai sorti la popote que j’avais enterrée dans le sable près de l’eau avec son restant de youchka ; j’ai allumé le feu et réchauffé la soupe avant de la manger avec des croûtons.
C’est alors qu’un de ces moments selon moi sacrés et donnant à ces fuites toute leur raison d’être, était sur le point d’arriver : près du feu, où de temps à autre j’ajoute quelque morceau de bois mort ramassés dans la journée, je suis tranquillement assis, à écouter le zoui-zoui des moustiques aux alentours. Et mon être, à mesure que la lumière tarit, se mêle au grand et universel silence de la nuit. Les pêcheurs ont abandonné ces berges depuis longtemps, les bronzés depuis plus longtemps encore, et il n’y a plus de chiens, plus de moujikets, plus de bagnoles. Dans le ciel plus un oiseau qui vole ; autour de moi plus âme qui vive, à part quelques canards sauvages partis pour caqueter au loin sur le lac où de temps à autre un gros poisson en plongeant laisse échapper un clac. Mais la grande sacralité du silence qui s’installe à mesure que le jour décline, ne perd rien de sa pureté, ce qui me pousse à croire que le vrai silence, c’est encore l’obscurité.
Certes, des braconniers traversent parfois l’horizon avec leur barque et leurs filets, mais ce sont des êtres sereins, prudents, méfiants, si bien que rompre ce silence n’est pas dans leurs habitudes, aussi voguent-ils sans mot dire jusqu’à se fondre dans le noir, telle l’ombre des ancêtres disparus ; ceci pour reprendre l’analogie avec Mékhaïlo Kotsioubenskéï.6L’Ombre des ancêtres disparus, sans doute le roman le plus connu de M. Kotsioubynsky, brillamment adapté au cinéma par Paradjanov dans Les chevaux de feu. Immuable, je reste assis là sans cligner d’un cil, à contempler le feu qui change de ton, danse et vacille en crachant ses étincelles vers le firmament, où ces dernières finissent par se perdre, ou plus exactement s’éteindre. Je plonge alors dans une étrange torpeur, pareille au nirvana, car à suivre son fil fatal, le feu nous tient comme envoûtés, pris dans le spleen, sorte de joie tranquille ; et ce n’est qu’à cet instant qu’on s’en aperçoit : le calme du jour paraît tout relatif et précaire comparé à la grande quiétude du soir, ce dernier semblant à son tour glisser telle la barque des braconniers, ou bien l’ombre des ancêtres disparus, dans la nuit. Car j’avais beau vouloir me distinguer des pêcheurs et autres bronzés : les accuser eux, c’était me viser moi ; j’avais beau transplanter leur existence dans un espace à part, je ne pouvais m’empêcher d’éprouver cette sensation que par la chair et le sang, nous ne faisions qu’un ; et ce n’est qu’à la tombée de la nuit, dans une complète et quiète solitude que je parvenais à me sortir du bien et du mal de la ville, acharnée qu’elle était à me poursuivre, à m’agripper et m’écorcher de ses doigts tentaculaires et griffus (en fin de compte, pêcheurs et bronzés n’étaient eux-mêmes que des tentacules) or à présent que j’étais de nouveau seul près de mon feu, j’avais le sentiment d’être enfin sorti de leur étreinte, — ça voulait dire que j’étais vraiment seul, ça voulait dire que je pouvais vraiment profiter de mes vacances, ça voulait dire que j’étais vraiment certain de n’en voir aucun débouler ici, à me demander ceci ou cela ou bien me sortir des histoires vraies ou fausses, ni même se rendre compte que j’en avais rien à faire.
Je devenais donc une part de cette obscurité — elle vivant en moi et moi en elle — avec pour seul gardien le feu qui veillait sur ce concubinage, feu qui frôlait mon visage de son souffle ardent, feu qui me parlait de choses éternelles bien que transitoires, feu projection de mon « moi » vivant au milieu de cet endroit désert ; d’ailleurs tout être humain, me disais-je, n’est qu’un feu dans le désert, encore que pour le ressentir clairement, il faudrait se tenir assis à moitié figé près d’un feu, en pleine introspection ; pendant ce temps, mon feu consommait tranquillement son dîner de branchailles sans même se jeter dessus, contrairement aux bronzés de tout à l’heure ; comme quoi aux heures sacrées, même le feu sait faire preuve de retenue.
L’eau du lac m’envoyait son souffle humide et je commençais vraiment à comprendre ce qui avait poussé les sages de l’Antiquité à voir en l’eau, l’air et le feu les principes premiers de l’Univers — car c’est vraiment ça. Ne me restait plus qu’une seule crainte : qu’un fauve, bipède ou quadrupède, surgisse de l’obscurité, auquel cas je me serais vu dans l’obligation d’user de violence pour me défendre ; ce à quoi d’ailleurs je m’étais toujours préparé durant mes escapades.
4
Depuis quelque temps, je cours le matin. En ville, ceux qui font ça dans la rue passent le plus clair du temps pour des ahuris, et si le petit citadin sédentaire et ramolli les toise d’un œil narquois, c’est que d’une certaine façon les courants résistent à la majorité des non-courants, lesquels ne courent pas les rues et ne s’empressent guère de le faire ; or j’ai beau me dire que le regard d’autrui n’a pas de prise sur moi, je ressens comme une gêne au fond de l’âme dès qu’on me regarde courir, — c’est que je ne dois pas faire partie de ces m’as-tu-vu qui se mettent sans cesse en avant, mon instinct dominant devant moins tenir du prédateur qui se croit tout permis que d’un animal autrement paisible ; en d’autres mots, je fais partie de ceux qui au nom de leur paix intérieure vivent ou essaient de vivre cachés dans leur petite maison d’escargot, parfaitement satisfaits de leur petit rôle discret. Ici, au milieu de ces prairies, je pouvais me permettre d’aller courir, pour ainsi dire, libre et sans complexe.
C’est dans cet état d’esprit que je sortis de ma tente le lendemain matin, m’étirant délicieusement. Or je fus conduit à sursauter, de stupeur entends-je : car sur cette petite plage où j’aimais à me prélasser, là même où j’attrapais mon poisson et enterrais ma popote, une créature de sexe féminin se tenait accroupie, vêtue d’une longue jupe en jean évasée qui la couvrait jusqu’aux pieds, assortie d’une petite blouse en jean elle aussi. La créature de sexe féminin traçait à l’aide d’un ramillon d’étranges zigzags sur le sable. Je laissai échapper un toussotement. La personne de sexe féminin tourna alors sa tête vers moi : c’était comme me prendre un seau d’eau glacée en pleine face ; elle se mit alors debout et repartit tranquillement le long de la rive sans se retourner, quoiqu’en laissant sa jupe évasée souligner ses déhanchements : pieds nus, elle allait. Je n’avais pas eu le temps de voir son visage, mais au demeurant la personne de sexe féminin avait l’air plutôt bien faite, quoiqu’un peu replète. J’avais également noté ceci : c’était quelqu’un de jeune. Dans la mesure où les bronzés ne venaient jamais s’aventurer de mon côté et les pêcheurs assez rarement, la presqu’île où j’étais installé étant défendue par d’épais ronciers sauvages, entrecoupés d’herbes hautes et rigides, tranchantes comme des couteaux —, grande fut ma surprise en découvrant la présence, à proximité de ma tente, de cette jeune-femme ou fille.
Pour arriver ici, elle avait dû probablement longer le lac, ce qui à pied n’était guère plus évident. Je restais donc planté comme un niquedouille, les yeux bêtement écarquillés et regardant partir au loin de son pas lent, indolent et presque langoureux, cette apparition qui devinant mes regards, étalait ses appas féminins telle un mannequin, quoiqu’avec plus de grâce, car cette grâce chez elle était innée, contrairement à celle des mannequins dressés à cela. Je la suivais d’autant plus du regard que je savais la personne de sexe féminin engagée dans un cul-de-sac avec au bout de son chemin des bourbiers et des marais s’étendant jusqu’au cœur de la presqu’île, elle-même entrecoupée d’un mur de ronces quasiment infranchissable.
La personne de sexe féminin était arrivée à hauteur des taillis sans se retourner une seule fois, puis, sans prévenir, elle finit par s’évanouir sous mes yeux, comme si elle avait plongé dans les fourrées et disparu aussitôt. Je restai ainsi ébaubi quelques instants, avant de jeter un œil sur le sable que la personne venait de fouler : aucune trace de pas.
Je secouai alors la tête, comme un cheval qui s’ébroue, avec cette drôle d’impression que j’allais bientôt me réveiller et que tout cela n’aura été qu’un mauvais rêve. J’oubliais : elle avait dessiné quelque chose sur le sable à l’aide d’un ramillon. J’y jetai un œil, le sable était lisse et intact ; or après les torrents de pluie de cette nuit, mes empreintes de la veille avaient elles-mêmes disparu. Je ne suis pas quelqu’un de superstitieux, je ne verse pas dans l’occulte, mais par trois fois j’ai crachoté par-dessus mon épaule. Puis j’ai refermé la tente en prenant soin de bien tirer les fermetures éclair en haut et sur les côtés, et surtout, de cadenasser les trois languettes — simple précaution contre une intrusion en mon absence —, puis je me suis rendu sur la rive, décidé à courir contre vents et marées ; au diable ces petites paysannes qui pour une raison qui m’échappe s’aventurent de bon matin sur des terres inhabitées, c’est leur problème ; par contre il fallait que j’aille vérifier à tout hasard, si s’il n’y avait de tente plantée sur le chemin par lequel elle était repartie.
J’étais déjà en train de courir le long d’un splendide sentier verdoyant où l’herbe pliait moelleusement sous mes pieds ; tout heureux, j’emplissais mes poumons de cet air humide et frais qu’en ville on ne trouve pas ; tout étincelait et luisait çà et là sous la rosée, c’était frais de partout, comme briqué et rincé à grand jets ; un mince filet de brume flottait au-dessus de ces étendues lacustres, ponctuées de silhouettes immobiles, faisant penser à des épouvantails de pêcheurs, avec leurs cannes et leur accoutrement quasi-militaire, à moins que ce ne fussent de vieilles souches d’arbres morts — d’ailleurs qu’importe, ils ne m’intéressent pas !
Je m’enfonçais de plus en plus dans le bocage, sautant par-dessus de petites mares brunâtres, ou bien, lorsqu’elles étaient trop grandes, passant à travers en faisait éclabousser l’eau jaunie et sale, tandis qu’une joie limpide s’emparait de moi à la vue du soleil-levant (juste là, à l’horizon) ample, jaune, pas tout-à-fait chaud encore et arrosant le monde de ses rayons d’or qui aux creux des tiges et des limbes égayaient herbages et feuillages dans leur bain de rosée. C’en était fini des regards narquois, j’étais seul sur cette route qui semblait sans fin, bien qu’au fond je sus où elle menait : au Dnipr, où d’ingrates bâtisses avaient été entassées, où gisait abandonné un vieux rafiot désossé par des jeunes sur une plage de sable gris abondamment souillée par les bronzés. Ayant bien sûr rebroussé chemin avant d’y parvenir, c’est désormais dans mon dos que dardait le soleil-levant, laissant mon ombre oblongue passer devant. Non, c’est merveilleux de se lever comme ça, aux aurores — la drôle de rencontre de ce matin m’était déjà sortie de la tête.
Or en prenant la contre-allée pour rejoindre ma petite tente, la même silhouette de femme toute-en-jean était brusquement réapparue, marchant au loin tranquillement, le dos face à moi, autrement dit, non pas dans ma direction, mais à l’opposé. N’ayant aucune intention de la revoir, je revins sur mes pas, le temps de faire un peu de gymnastique au bord du chemin principal durant une petite demi-heure. Après quoi, je repris la direction de ma tente avec, je dois dire, une certaine appréhension : c’est que retomber nez à nez avec la personne de sexe féminin n’était vraiment pas dans mes projets. Arrivé au bivouac, je piquai une tête puis allumai le feu pour la popote, — j’avais l’intention de me faire du thé, ce qui avec quelques croûtons de pain sec devait constituer mon petit-déjeuner. Le temps que l’eau se mette à bouillir, j’attrapai quelques appâts et installai mes lignes. C’est là que j’aperçus au loin dans le lac, une espèce de bête rampante : couleuvre ou serpent, nageant la tête hors de l’eau. Évitant d’instinct tout ce qui rampe, je ressenti un frisson en me disant qu’il valait mieux fermer la tente complètement cette nuit, sinon j’étais bon pour recevoir une fois de plus un de ces rampe-par-terre et assimilés. C’est alors que le bouchon se mit à dodiner, avant de prendre le fond ; je soulevai ma canne et de l’eau sortit une petite perche.
Ça commençait à bien mordre, et poisson après poisson, j’atteignais bientôt mon quota quotidien. Ma popote étant arrivée à ébullition, j’y jetai le thé et le laissai infuser hors du feu. C’est là qu’à nouveau j’aperçus, de l’autre côté du lac, autrement dit sur la plage des bronzés-en-bagnole (ainsi les définis-je), cette fille ou cette femme toute-en-jean mélancoliquement assise au-dessus de l’onde, sur une branche affaissée ; elle avait, semble-t-il, les yeux tournés dans ma direction, et vu la distance, son visage était toujours impossible à distinguer.
C’est curieux également, mais aujourd’hui les pêcheurs semblaient avoir mis les voiles vers quelque rivage lointain ; il n’en restait plus aucun dans les parages, aussi me retrouvais-je pour ainsi dire seul à seul avec la personne de sexe féminin.
La nature humaine doit connaître son lot d’étrangetés elle aussi, car pour une raison que j’ignore, j’étais déjà en train de regretter de ne pas l’avoir rattrapée tout à l’heure sur le chemin, histoire de voir comment elle était : belle ou vilaine ? À peine avais-je commis cette pensée que j’en étais déjà à me lancer de pieux reproches : mais qu’est-ce que ça peut bien faire, qu’elle soit belle ou vilaine ? C’est sa vie, elle peut bien errer où bon lui semble, je n’en fais pas grand cas ; d’ailleurs conter fleurette ne m’intéresse plus depuis longtemps comme je m’en confiais plus haut, et pour aller au bout de cette confession, j’avoue que n’ai jamais été porté sur la chose, qui plus est, j’ai toujours la ferme intention de préserver ma liberté.
J’ai donc tourné le dos à cette chimère, avant de remplir mon quart, attraper deux ou trois croûtons, déplier la chaise en toile à cause du sable encore mouillé, pour me poser enfin et prendre le thé tranquillement. Mais prendre le thé tranquillement n’était plus de mise, la personne de sexe féminin sur la rive d’en face s’étant relevée, entamant un lent déshabillage ; et bien que ma position fût complètement oblique au regard de la sienne, je ne pouvais pas ne pas remarquer son petit manège. C’est ici que ma nature masculine se vit brusquement tirer de sa torpeur ; bon gré mal gré, je n’étais plus assis de côté, mais bien en face d’elle, assistant désormais à ce lent striptease sans pouvoir en décoller mes yeux. Elle retira d’abord son chemisier, laissant éclater au grand jour de généreux seins blancs que rien ne recouvrait d’ailleurs. Puis elle jeta son vêtement par terre, sans jamais regarder dans ma direction, mais en exhibant clairement ses appas. Elle resta ainsi un moment, à jeter ses feux à demi-nue, puis elle dégrafa sa jupe en jean, laquelle glissa à ses pieds. Un petit pas dehors, et elle reprit ses déambulations au bord de l’eau : ne portant rien qu’une petite culotte couleur chair, elle donnait de loin l’illusion d’être nue. Je sentis ma gorge tressaillir et mon corps trembler ; pourtant mes yeux se refermèrent chastement, car la même sensation me prenait de nouveau : ce que je voyais-là ne pouvait être qu’illusion.
Lorsque j’ouvris les yeux, la personne de sexe féminin ôtait d’un geste lent sa petite culotte, avant de la jeter négligemment sur le côté ; son corps étonnant de clarté pétillait dans le soleil matinal. Elle se tenait au-dessus de la rive telle une sculpture sublime, et moi qui ne me sentais plus la force de bouger, pas même d’un poil, j’étais pris de l’hébétement le plus total ; ma chair se raidissait, mes yeux m’échappaient, envolés depuis longtemps vers cette illuminée de soleil et de ce fait ardente apparition, merveille des merveilles qui n’en finissait pas.
S’avançant sur le sable au plus près du bord, elle toucha l’eau de la pointe du pied. Soudain une onde chatoyante embrasa les eaux, comme si de cet endroit avait jailli l’étincelle. Alors que mon thé aux croûtons détrempés était en train de refroidir dans ma main engourdie, je la regardais et la regardais encore, incapable d’en décoller mes yeux. Elle se promenait sur le sable humide et durci, tout en me laissant admirer sa plastique sous tous les angles : de côté, de face, de dos, comme pour faire valoir ses arguments, qu’elle avait convaincants je dois dire. Puis elle entra dans l’eau, très lentement, pouce par pouce, peu à peu immergée et soustraite de ce fait à mon regard enflammé, jusqu’à ce que sa généreuse poitrine vienne s’étendre à fleur d’eau, ‒ c’est alors qu’elle s’élança pour nager. Non pas de mon côté, mais le long de la rive, la tête hors de l’eau ; alors me saisit l’idée complètement folle qu’elle était en train de nager comme l’autre espèce de bête rampante : couleuvre ou serpent.
Tressaillant des pieds à la tête, j’essayais d’échapper à ce leurre, car oui, j’en étais désormais certain, c’est bien à un leurre que j’avais à faire, là, en face, et il m’était impossible de bouger, ne serait-ce que d’un pouce, pour sortir enfin de cette mystérieuse torpeur, comme si l’on m’avait hypnotisé, envoûté ou que sais-je !
La personne de sexe féminin ne nageait plus depuis un moment, elle s’était mise debout et commençait à revenir au sec, me dévoilant d’un geste toujours lent sa chair dénudée. Et ce corps étincelait de nouveau à fleur de soleil, comme recouvert d’or, et bien plus encore, à présent que la lumière s’ébattait sur l’humide. Elle atteignit la rive et commençait à se revêtir aussi nonchalamment qu’elle s’était dévêtue : elle enfila d’abord sa petite culotte puis sa jupe en jean par-dessus sa tête, elle se reboutonna et se tint immobile, les seins à l’air quelque instant avant de remettre sa petite blouse. Elle reprit sa promenade le long de la berge, faussement indifférente et pensive, comme si je n’étais pas sur la berge d’en face, puis elle continua ainsi sans jamais se retourner, jusqu’à s’effacer de ma vue. Je replis mon souffle, tremblant comme une feuille. D’ailleurs, j’en avais après cette vicieuse : faisait-elle métier de son corps ou qu’est-ce ? Or, s’il y a bien une chose qui m’avais mis hors de moi, c’est que moi, moi et ma stoïque posture, ma haute sapience, ma pédante froideur et mon renoncement aux plaisirs d’ici-bas, je m’étais comporté dans cette affaire comme le plus veule et le plus minable des bouffons. Non pas vis-à-vis d’elle, mais de moi. Quelle honte !
5
Par conséquent ma sérénité et mon humeur toute intermezzienne, si je puis m’exprimer ainsi, étaient anéanties. Je décidai de quitter cet emplacement, aussi commode fût-il, pour m’enfoncer dans un coin perdu où il n’y aurait ni bronzés-en-bagnole, ni paysannes vicieuses en mal de chastes ermites, et moins de pêcheurs, bien qu’à l’inverse des bronzés et des paysannes que l’on pouvait éviter, les pêcheurs, eux, ne risquaient pas de l’être : c’est que cette petite république aussi obstinée qu’envahissante, est capable de coloniser les moindres recoins, d’ailleurs dans ces parages il y en a toujours eu et il en reste encore beaucoup. Cela dit, rivés qu’ils sont à leurs cannes et leurs bouchons, on peut toujours s’arranger avec les pêcheurs ; le monde alentour les indiffère, ma personne d’autant plus. Le pire, c’est que le coin regorgeait d’appas, ce qui facilitait la pêche, or je n’avais pas assez de provisions avec moi. Au nouvel emplacement, il me faudrait de nouveau attirer le poisson avant de pouvoir le pêcher. D’un autre côté, la prairie ne manquait pas d’oseille sauvage, j’allais donc pouvoir me faire un bortch vert, à l’oseille sauvage. Voilà qui était rassurant, j’ai donc commencé à plier bagages. Ce qui m’a pris pas mal de temps (pour être tout à fait honnête) à force de guetter ici et là l’éventuelle réapparition de la paysanne-en-jean ; mais elle n’est pas réapparue. Grâce au ciel, me suis-je dit. J’ai enfilé mon sac à dos, pris mon sac de provisions dans une main et dans l’autre la canne à lancer enfilée dans son étui, puis j’ai mis les voiles.
Or au détour d’un chemin, un nouvel imprévu m’attendait : un serpent avait déboulé des fourrées, quasiment sous mes pieds. Il ne s’agissait pas d’une couleuvre, ça, je l’avais bien vu à l’absence d’anneau jaune sur sa tête, ainsi qu’à sa façon de siffler et de se cabrer. Effrayé, j’avais fait un bond en arrière et m’étais mis à courir, encore que courir chargé comme j’étais n’avait rien d’aisé. Je finis par m’arrêter pour regarder derrière moi : le serpent n’était pas à mes trousses. Vu que je portais des bottes en caoutchouc, je m’étais peut-être affolé un peu vite, mais la peur bien souvent l’emporte sur le bon sens et la jugeote. D’ailleurs j’étais déjà en train de contourner l’obstacle, en prenant garde où je mettais les pieds.
Plus rien désormais n’entravait ma progression, j’avançais droit devant, inondé de sueur sous cette chaleur qui devenait étouffante à mesure que je m’enfonçais dans le bocage. Je restais néanmoins sur mes gardes, imaginant des serpents et des couleuvres arrivant de partout ; et lorsque mon pied butait contre une tige rampante au milieu des taillis, je scrutais l’endroit la peur au ventre. Je regardai enfin du côté par lequel j’étais arrivé et de nouveau m’apparut cette silhouette de femme solitaire qui cette fois marchait dans ma direction, autrement dit, face à moi. Son visage était cependant trop éloigné pour être discernable. Je jurai par tous les diables et crachai encore par trois fois, en lâchant comme par superstition un incantatoire « crève et disparais, maudite créature ! », avant de m’en retourner prestement dans le sous-bois, alors que je pouvais très bien continuer le long de la route : mais des fois qu’elle me suive, me disais-je, idée complètement sotte ça aussi.
Là serpentait un sentier à peine marqué, avec de chaque côté d’épaisse touffes de laîches, et plein de boue aussi. J’ai dû traverser plus d’une ornière avant de tomber sur un autre lac, mais tellement infesté de pêcheurs, que je ne m’y suis pas arrêté. D’ailleurs, je savais que l’eau du lac sentirait la vase, alors qu’il me fallait de l’eau claire pour la youchka et le thé.
Je me retournai une fois de plus, pour voir si l’espèce de chimère n’était pas derrière moi ; mais elle n’y était pas. Et puis à quoi bon me persécuter comme ça, sans raison ; non, ce devait être encore une de ces foldingues en mal d’élégies champêtres, et assez insolente avec ça, pour jouer avec mes nerfs, sachant très bien que je n’allais pas enjamber le lac pour lui tomber dessus. Elégies qui allaient mal finir pour elle, pensais-je encore, si jamais des pêcheurs passablement éméchés venaient à la violer seule et sans défense ; après quoi, me dis-je non sans rancœur, la poésie des champs ne risquerait plus de la charmer, parce que tout le monde n’est pas capable, comme moi, de fuir les tentations féminines. — C’est ça, amuse-toi ! marmonnai-je méchamment. Un de ces quatre, tu t’amuseras moins !
Ce ton rageur avait de quoi me surprendre moi-même, car enfin, pourquoi m’emporter de la sorte ? D’accord, j’avais croisé plusieurs fois une espèce de folasse ; d’accord, elle s’était baignée toute nue dans un endroit sauvage et retiré — mais qu’y avait-il de si insolite ?
Je longeais un sentier, toujours à pas prudents, jusqu’à parvenir aux abords d’un lac ; des voitures étaient garées là, portières ouvertes des deux côtés, — autrement dit, pas de place pour moi ici non plus. C’était des bronzés, toute une nichée : un vieux, une vieille, des entre-deux-âges, et des plus jeunes, avec une ribambelle de moujikets batifolant dans l’eau à l’en rendre bouillonnante. Par terre des nappes, et sur elles, comme dans l’interminable comptine du pope qui avait un chien : des bouteilles, des thermos, des casseroles, pots, conserves, fruits, légumes.
Je passai mon chemin, sachant qu’un peu plus loin se trouvait un autre lac, ou plutôt un étang à l’eau plus ou moins claire. Si jamais rien ne se présentait là-bas non plus, j’allais devoir improviser, ne connaissant pas d’autre coin dans les parages. Sur ces entrefaites, le sentiment d’être suivi ne me quittait pas davantage. Je m’arrêtai donc à plusieurs reprises, me dissimulant parfois derrière la branche d’un chêne pour guetter ma poursuivante, mais bien évidemment ces craintes n’étaient que le fruit de mon énervement. Sotte nature que celle des hommes : elle peut les rendre insatiables de femmes, tout comme leur ôter le moindre penchant pour cette gente et en faire de parfaits asexuels. Mais dans ce cas, mieux vaut fuir les tentations, parce que les tentations ça excite le côté sombre de l’être masculin, si bien que l’individu finit par ne plus s’appartenir, un peu comme ces alcooliques abstinents qui une fois parvenus à leurs limites vont s’envoyer un verre machinalement. Et là, c’est reparti : un verre, puis deux, puis trois, et le sujet, symboliquement parlant, se retrouve sous le joug : qui de la bibine, qui de la chair féminine. Je me suis dit alors qu’il fallait se tenir sur ses gardes et savoir se montrer à la hauteur au moment de la tentation. En somme, j’étais en train de me glorifier d’avoir quitté l’ancien emplacement, jusqu’à voir en cette désertion une marque de bravoure et de sagesse. Ainsi vont les choses, pour sûr. Savoir se convaincre soi-même, c’est savoir se dominer, et la maîtrise de soi suscite en retour un surplus de courage. De courage, ou de faiblesse, peu importe, pourvu qu’on n’y laisse pas sa liberté. Ainsi voyais-je un rapport entre le sentiment d’être suivi et les inhibitions engendrées par les troubles causés à ma tranquillité et mon humeur tout intermezzienne, alors que j’aspire à me ressourcer et me renforcer spirituellement ; c’est pourtant simple : on fuit le monde non tant par courage que par manque de courage face à lui.
6
Sur le lac où je venais d’arriver voguaient des canards sauvages. Ils s’arrachèrent à la bande de roseaux qui longeait la berge et dans une nuée de cris s’envolèrent ailleurs. Fort bien, me dis-je : au moins ici, c’est vide et désert. Je trouvai un petit coin, libre de roseaux et recouvert de sable ; près du bord, des piquets de lignes pointaient au-dessus des flots. On pouvait donc pêcher ici. Et par chance, de pêcheurs il n’y avait point. L’eau semblait pure. Je commençai à monter ma petite tente en retrouvant peu à peu ma sérénité. Après quoi je ramassai un peu de bois mort, allumai le feu et accrochai ma popote.
Me revoilà donc seul, un ciel parfaitement pur s’éploie au-dessus de moi, tandis qu’un soleil radieux me couvre de ses généreux rayons ; je suis couché sur le sable, nu et enduit d’une crème contre les insectes volants et piquants, car il en grouille ici davantage qu’à l’ancien emplacement ; je regarde les nuées éclatantes de blancheur, passer lentement ; près de moi, le bortch bloubloute délicieusement ; l’eau par moments se couvre de petits cercles concentriques — le poisson est de sortie. Le calme et le silence exquis étaient donc revenus, même les oiseaux tout là-haut, semblaient calmes, alanguis. Plus de mouettes rieuses pour m’agacer, le sable attendri sous mon corps me tenait chaud, tandis que de l’autre côté de l’étang une immense plaine couverte d’herbes hautes ondulait lestement. Personne non plus pour troubler mes agapes : je pouvais passer à table et profiter de mon repas le plus sereinement du monde, après quoi j’enfilai ma casquette pour rêvasser tranquillement, à demi-endormi, et la seule chose qui venait venir troubler ma quiétude dans cet état, c’est qu’émergeait parfois à mon regard ce corps nu de femme illuminé sur la rive, avec d’ailleurs un entrejambe, non pas duveté ou rasé de manière habituelle, mais doté d’une friche exubérante, et c’est précisément cette friche qui m’avait le plus troublé.
J’ouvrais donc à nouveau les yeux afin d’en chasser cette vision, or ils retombaient avec joie dans l’abyssale profondeur des cieux que le lac à son tour reflétait, puis, comme dans un poème de Svidzenskéï7Volodymyr Svidzynsky, poète ukrainien atrocement assassiné par le régime stalinien en 1941., il me prit subitement l’envie d’entrer dans ces eaux aux reflets célestes et d’avancer en elles sans plus m’arrêter, jusqu’à toucher le fond du mystère suprême, toucher le néant, n’ayant ni l’odeur ni l’aspect ni quoi que ce soit de périssable, étant lui-même une grandiose, autrement dit extatique sensation d’infini. J’en avais presque esquissé un sourire : j’étais bien, j’avais retrouvé la quiétude et, à partir de là, je pouvais me sentir à nouveau moi-même.
Un peu plus tard, je retrouvai assez de calme pour me rhabiller, renfiler mes bottes en caoutchouc, et malgré ma dégaine d’ahuri, battre la broussaille jusqu’à m’assurer qu’aucune couleuvre, aucun serpent n’y circulait. J’avais pris en guise de matraque un bon bout de chêne que des pêcheurs avaient laissé là, et ainsi armé, je pouvais me sentir à nouveau plein de vigueur et de fermeté face à ces rampants que j’avais bien l’intention de mater. Or j’avais beau battre l’herbe environnante et remuer la vieille souche croulante d’un arbre à moitié pourri : aucun reptile en vue. Voilà qui était tout-à-fait rassurant, car ce soir j’avais bien l’intention de me faire, comme j’aime à le faire, une petite séance intermezzienne près du feu, autrement dit, passer un peu de temps près de lui sans plus me soucier de rien, jusqu’à me fondre en douceur dans l’ombre vespérale, — et il le fallait vraiment si je comptais échapper aux mauvaises ondes de cette embrouillante, énervante et, par là-même, sale journée.
7
Mais rien ne s’est passé comme je l’aurais voulu. J’ai bien eu ma séance intermezzienne près du feu, sauf qu’au lieu d’une extase de sérénité, j’ai ressenti ce que j’appelle un « spleen mi-automnal » ou comme l’exprime bien mieux Eugène Ploujnyk8Encore un poète ukrainien mort aux îles Solovki durant les répressions staliniennes. Promis au peloton, la tuberculose l’exécutera la première., mon idole en poésie, un prélude de calme et d’ennui, autrement dit, non pas le calme lui-même, mais son avant-goût, désir qui s’accompagne d’une jouissance sans grande aspiration, mêlé de lassitude, ce qui, selon Grégoire Skovoroda, entraîne un sentiment d’inassouvi. Par ailleurs, cette journée n’avait été que trop épuisante, je rejoignis donc ma couche avant l’heure pour m’emmurer, tel un escargot dans sa petite maison, sous ma tente.
Je noyai le feu, tirai les fermetures éclair et m’enfonçai dans mon sac. Sur le lac entretemps s’étaient posés des canards sauvages cancanant à tout-va : c’est qu’ils ont leurs vies, eux aussi, avec leur lot de passions, de tracas ou de souffrances. Le chant des grillons n’avait pas encore commencé, nous n’étions qu’au mois de juin, mais quelque chose dans l’obscurité couvrait déjà la nuit d’un léger friselis. M’étirant délicieusement, je m’endormis aussitôt.
A propos de ce qui s’est passé par la suite, je ne saurais dire avec certitude si ce fut un rêve ou si tout s’est vraiment déroulé ainsi, mais c’est bien le genre de choses qui n’arrive que dans les rêves ou les histoires fantastiques, autrement dit, dans un univers d’illusion ; voilà pourquoi j’incline à croire que c’était bien un rêve, mais un rêve si profond et réaliste qu’il vaut bien la réalité elle-même ; par conséquent, il est tout à fait possible d’y voir comme un jeu ou un reflet du réel, et donc d’y croire comme en une sorte de réalité augmentée, ‒ quoi qu’il en soit, trouver quelqu’autre explication à ce qui m’est arrivé serait au-delà de mes forces.
Je n’ai pas souvenir de l’heure à laquelle c’est arrivé, je sais juste que des canards effarouchés m’avaient réveillé. Gardant toujours au cas où, ma lampe-torche à ma gauche et ma petite hache à ma droite, ma main avait pu rallumer en un éclair. La lampe était justement braquée sur la petite embrasure où les languettes se rejoignent, c’est alors que je vis, s’insinuant par la fente, une tête vipérine et luisante dans le faisceau de lumière ; elle a sifflé puis s’est mise à glisser en tombant à mes pieds. Je me suis recroquevillé, puis j’ai attrapé ma petite hache. Etrangement, je commençais déjà à perdre mes moyens, ma tête me tournait, mes doigts s’étaient ramollis et j’étais transi de peur ou de stupéfaction : le serpent s’était mis à fumer et sa fumée qui n’était au début qu’une simple nuée grise, prenait peu à peu forme humaine, — la spectrale matière grossissait à vue d’œil et ne cessait de grossir, jusqu’à épouser la silhouette de ce qui m’apparut subitement comme celle d’une femme : et qui d’autre pouvait-ce être, si ce n’est cette désormais familière personne de sexe féminin toute-en-jean, mis à part son visage que je n’arrivais toujours pas à discerner — on aurait dit qu’un voile épais le cachait.
— Je t’ai fait peur ? demanda la personne de sexe féminin, en se recroquevillant sur ses genoux, la tente étant exiguë. Je me taisais, ma langue ne répondant plus : si j’ai eu peur, c’est peu dire, j’étais terrorisé. — N’aie crainte, me rassura la femme d’une voix douce et profonde. Tu n’as qu’à me chasser et je partirai. Mais si tu veux, on peut discuter. — Mai t’es qui d’abord ? articulais-je à peine. — Éteins ta lampe, me pria-t-elle, elle m’aveugle. — Mais on n’y verra plus rien ! — Si, m’assurait la femme. Tout ce qu’il y a à voir, tu le verras.
J’obéis et éteignis la lampe. Alors une curieuse petite lumière, douce et vacillante, tenant du mirage, inonda ma petite tente ; il y en avait assez pour l’éclairer aussi bien qu’avec ma torche, bien qu’à l’inverse de cette dernière, qui n’éclairait qu’une partie de l’espace, à présent tout l’intérieur de la tente était baigné de lumière.
— Tu me fuyais ? demanda tristement la personne de sexe féminin. Tu as eu peur, ou bien je ne te plais pas ? — J’aime pas les petites vicieuses ! clamai-je orgueilleusement. — Mais comment aurais-je pu attirer ton attention, toi qui évite et fuis tout le monde ? demanda-t-elle tristement, tandis que j’essayais de voir son visage ; non, il était encore à moitié estompé.
— Tu aurais pu choisir quelqu’un d’autre, dis-je d’un ton agacé. Tu trouves que ça manque de monde par ici ? Ne serait-ce que ces pêcheurs, tiens… — Quoi, ces jobards ? plaisanta derrière son voile la personne de sexe féminin. Ou comme on dit de nos jours : ces débiles. — Et moi, j’en suis pas un de débile ? — Oh que non ! m’assura-t-elle. Toi, tu es différent, intelligent, peut-être trop même. Trop, parce que ton intelligence te rend inadapté, ou inapte, je ne sais pas. Non, je dirais inadapté…
— Inadapté à quoi ? — Mais à la vie, fit-elle. C’est à dire à l’épreuve du monde. Tu finis toujours par fuir, par te cacher, t’es marrant… Tu inventes toujours quelque chose, tu compliques tout, et puis tu joues les solitaires. Mais débile, ça, tu ne l’es pas. D’ailleurs moi aussi je fuis tout le monde et me caches tout autant.
Nous nous sommes regardés l’un l’autre un certain temps, puis j’ai commencé à ressentir comme un trouble ou un émoi jusqu’alors inédit, mais ce n’était plus de la peur ni de l’effroi ; on eût dit un début d’intérêt. Quoique non, la peur était toujours là ; et pourtant ce regard qui affleurait de son visage à demi-effacé me fascinait, ou m’hypnotisait, aussi tombais-je peu à peu dans une sorte de vertige. J’avais l’impression que les parois de ma petite tente s’étaient mises à fondre comme peut fondre une matière plastique sous l’action du feu, jusqu’à la tordre et la transformer en eau noire.
C’est alors qu’apparut au-dessus de ma tête un ciel parsemé d’étoiles, avec un clair de lune si vif que tout en était devenu visible alentour ; encore que cette lumière fût morte et que sous cette lumière morte les dehors de cette femme ou fille en fussent devenus flottants, liquides, hésitants, comme si à tout moment sa chair vaporeuse pouvait telle la brume se dissiper. Et sur un arbre un peu plus loin, il est vrai desséché depuis longtemps, avec ses allures de sculpture contemporaine, des branches nues, éteintes et salement blanches, laissaient perler quelques gouttes de rosée : l’une tombait dans une flaque en faisant floc, l’autre dans la verdure tout en murmure. Et plus la fille (ou la femme) me regardait et me regardait à n’en plus finir, plus je ressemblais à cet arbre mort, le corps pris de tremblements, ainsi qu’il arrive lorsque la chair est sollicitée. Pour autant, je ne comptais pas me rendre.
— Qu’est-ce que tu me veux ? protestai-je, presque sans voix. — Tu ne le sais donc pas ? dit-elle en étouffant un petit rire charmant, et ce rire se déversa en moi comme de l’eau vive, ou morte, à moins que ce soit les deux.9NDT : Allusion aux eaux miraculeuses des contes slaves et baltes : « L’Eau vive » pour la force, « L’Eau morte » pour la faiblesse. — Mais si, tu le sais bien. Toi et moi, nous le savons !
Je comptais répondre, dire quelque chose d’un peu rude, d’un peu vache, mais ma langue n’était plus qu’un pal dans ma bouche à cause de cette petite blouse en jean qui était sur le point de tomber. Elle la passa par sa tête, et de cette petite blouse retomba une lourde, opulente et pendillante paire de seins. Sous les rayons de lune, on eût dit des fanaux qui s’allument. C’est alors qu’un canard quelque part, poussa plaintivement son cri avant de se taire subitement, comme si on lui eût coupé le sifflet. A moi aussi, d’ailleurs. Je venais de prendre une grosse bouffée d’air. Puis elle jeta négligemment sa petite blouse sur le côté, et mes yeux complètement subjugués contemplèrent son corps à moitié dévêtu.
— C’est ça que tu veux ? demanda-t-elle discrètement. J’en avais presque avalé ma langue, tandis qu’un drôle de glougloutement passait dans ma gorge : — Mais non ! bourdonnai-je, non !
— Alors, chasse-moi ! — sa tête dévotieusement inclinée me donnait à croire que les choses allaient être plus faciles, autrement dit, je ne me sentais plus comme cet arbre mort et desséché, quoique pour trembler, je tremblais ; d’ailleurs un arbre mort dans le vent, ça doit trembler aussi. Son regard avait cessé de me captiver et hypnotiser, même si une sorte de vertige me tenait toujours à sa merci. Ma main resserra alors la petite hache.
— On peut faire ça aussi ! susurra-t-elle. C’est ça, découpe-moi ! N’aie pas peur ! Vas-y !
Mais ma main était devenue morte. Comme une branche d’arbre mort. Morte également ma petite hache, dont seule la lame brillait au clair de lune. Alors je décidai de la chasser : cette rencontre n’augurait rien qui vaille. Je n’avais qu’à faire mine de m’emporter un peu et elle serait repartie. Cependant mes yeux ne m’appartenaient plus et mangeaient indépendamment de ma volonté l’opulente, frémissante et lumineuse poitrine, en restant rivés sur elle comme ceux d’un pêcheur sur son bouchon. J’étais moi-même en quelque sorte un de ces pêcheurs, n’attendant plus que mon bouchon s’agite et prenne le fond. Je n’aurais alors qu’à remonter mon bâton et une charmante roussalka10Roussalka : sirène dans la mythologie slave. se balancerait au bout. D’ailleurs, elle s’y balançait déjà : assise juste là, face à moi. L’horreur ne quittait toujours pas mon corps. Mais l’attitude soumise de la captive roussalka avait suffi à mettre le feu à mes sens d’être masculin excité, ‒ ce même feu qui s’était déclaré ce matin, et à cause de cette même roussalka se baignant nue sous mes yeux, parfaitement consciente de ce qu’elle faisait, et à quels desseins.
Bien que toujours voilé, je crus déceler comme un sourire sur son visage. Elle se leva et déboutonna sa jupe en jean ; celle-ci tomba à ses pieds, et elle en sortit comme d’un buisson. La lumière autour de nous était devenue sombre et froide, — moi j’étais de braise. Elle s’assit de nouveau sur ses genoux face à moi, ne portant rien d’autre que sa petite culotte couleur chair, tandis que sa tête dévotieusement inclinée ne dévoilait toujours pas son visage comme plongé dans l’ombre au milieu de son corps tout étincelant, — cette pause m’évoquait celle d’une antique divinité.
— Chasse-moi ! susurra-t-elle. Ou bien tue-moi !
J’étais déjà tout-à-fait certain de ne pas la chasser, encore moins de la tuer, et même si ma main reprenait vie, elle finit par lâcher la petite hache au lieu de la serrer. J’étais toujours glacé de peur, mais j’avais cessé de trembler. Dans le ciel, la lune gonflait tel le pain sur son levain, tandis qu’un feu pâle doucement l’embrasait ; et devant moi, nimbée dans cet ensorceleur halo, se dressait une sculpture de déesse, monument d’or et d’argent aux formes et aux lignes si pures qu’elle ne pouvait pas ne pas m’éblouir.
— N’aie crainte ! disait-elle tristement, à tel point que cette tristesse m’avait surpris. Je suis toute entière à tes volontés ! Tu peux faire de moi ce que tu veux, vraiment tout !
Je me sentais tout petit devant tant de beauté, et plus intimidé encore face à cette puissance virile qui montait en moi ; dès lors, je n’étais plus maître de moi-même, j’en avais la langue desséchée cependant que mon corps n’était plus cette vieille souche inerte, mais un arbre vivant, plein de sève giclant dans ses branches et feuillées.
Alors elle se leva pour ôter son ultime équipage. Et la nuit m’apparut. Profonde et sombre, sans lumière, touffue, charnue, pleine de rosée et de noirceur, qui dans ses tréfonds redoublait de noirceur, qui elle-même redoublait de noirceur. Et toute cette noirceur venait sur moi et en moi, car j’avais beau noir-bouillir comme poix fondue dans un pot noir, je ne lui avais toujours rien dévoilé de mes émois, collé que j’étais au fond du sac de ma volonté, sans même bouger le petit doigt pour la faire venir, ‒ quant à la faire partir…
Puis tout brusquement dans ma tête s’embrouilla, je sentis une force me pousser de l’intérieur, celle-là même qui allait me vider de mon sac comme on vide un tube de crème ou de peinture ; celle-là même qui par une étrange opération allait racler mes vêtements du bas comme on racle une pomme crottée. La fille me saisit par les jambes et d’un coup sec me tira vers elle ; tombant à la renverse, je sentis quelque chose de froid et d’écailleux grimper sur moi ; alors ma chair déjà dure comme de la trempe plongea dans un bain ardent. Le reste de mon corps, pourtant, semblait figé de froid. Juste sous mes yeux, des seins opulents et lumineux s’étaient mis à dodiner, j’attrapai dans ma bouche un des tétons, le suçotai comme un nouveau-né, et me délectant de l’un comme un nourrisson, je passai à l’autre pour le suçoter à son tour. La femme sur moi en avait gémi de plaisir, après quoi elle s’était penchée tout contre moi, et bien que je ne visse davantage son visage (il s’estompait sans cesse devant moi) j’entendis d’avides chuchotements mêlés de sades gémissements :
— Voilà ce que je voulais… et c’est ce que tu voulais aussi, nan-han?.. C’est bientôt la fin, ce monde ne veut pas de nous-ouh!.. sans vous les humains, on va bientôt disparaître et crever-héé!.. à cause de vous, les bipèdes, aaah ! Mais je sauverai mon espèce ! Je mettrai au monde un fils qui sera aussi le tien-hein.. ! Intelligent et venimeux, malin et vipérin-hein… ! Il aura ton intelligence et mes crochets à venin ! Il n’aura ni ta faiblesse ni mon côté précaire. Il sera rusé… rusé comme un serpent !
Alors je sentis dans l’enfer où grillait mon bâton un volcan qui entrait en éruption, crachant son nuage de cendre, de feu et de lave, origine du monde et de la vie. La terre s’ébranlait, les arbres en perdaient leur feuillage, l’herbe verte sa fraîcheur. Un nuage de fumée avait recouvert le ciel et la terre. Puis au-dessus de moi, le rire lubrique et satisfait de la femme-serpent retentit :
— Non, je ne vais pas te laisser de sitôt, siffla, ou plutôt persifla-t-elle, alors qu’elle m’enchaînait de ses membres enlaçants. Elle se mit sur le dos et me hissa sur elle. Toute ta substance, je vais la prendre et la sucer jusqu’à la moelle ! Finis ta besogne ! Tu ne risques pas de recoucher avec qui que ce soit après ça !
Alors j’ai besogné, mécaniquement, comme un automate, bien qu’étant complètement vidé et à moitié-mort ou presque. Et de nouveau cet enfer que je pénétrais jetait ses flammes et mon bâton n’en finissait pas de griller. Mon corps pendant ce temps était glacé jusqu’à transir et se raidir de froid, j’étais à deux doigts de perdre connaissance et bien qu’à bout de forces, je ne pouvais m’arrêter. Sous le mien, le corps de la femme-serpent se tortillait de plus belle et ses lèvres s’abreuvaient des miennes en les pompant par la langue et par la bouche. Et de nouveau ma chair explosa, de nouveau la terre trembla, et dans un torrent de lave, au milieu des flammes, mon bâton finit par périr ; la femelle étreinte se relâchant, je parvenais à me retirer pareil à un gland de noisette tiré de sa peau verte ; et je roulai défait, sur le dos, dans un dernier soupir.
Seuls mes yeux à peine ouverts trouvaient assez de force pour voir ce qui se passait et voici ce qui m’apparut : la femme s’était mise sur ses genoux et tirait les fermetures éclair de la petite tente, je devais y être revenu ; elle ramassa ses petites affaires tout-en-jean et s’en partit dans la nuit. Son corps demeurait lumineux quoique moins vivace. Après quelques pas, elle s’arrêta pour remettre ses habits le plus tranquillement du monde. Passant d’abord sa petite blouse, ses seins comme la moitié de sa personne, s’éteignirent, après quoi elle fit glisser sa petite culotte et en revêtant sa jupe, ses jambes encore lumineuses s’éteignirent à leur tour ; elle n’était plus alors qu’une ombre dont ne scintillaient que les mollets, la nuque et les mains restées nues.
Se retournant vers moi, elle resta muette, ne voyant sans doute là qu’un vil morceau de chair putrescente, fanée, vannée, pressée comme un vulgaire citron, végétant sur son sac de couchage, froissé comme une chose complètement éteinte hormis ses prunelles qui ne l’étaient pas encore. Et ces prunelles, c’était celles d’un homme qui dans sa suffisance se croyait libre, celles d’un homme qui décochaient vers la femme-serpent leur lueur automnale, bien qu’à mon avis, ce regard noyé de tristesse ne l’ait jamais atteinte. Elle finit par s’éloigner de la tente cette ombre aux pieds d’or et aux mains d’argent ; en s’approchant de l’onde, elle avança sur le lac, et de ces eaux-calmes une nuée d’oiseaux s’arracha dans un grand cri d’effroi. Elle marchait à la surface du lac comme s’il était de glace, ce qui en plein mois de juin n’avait aucun sens ; puis, ceinte de cette lueur qui émanait de ses pieds, de ses mains et de sa nuque, peu à peu elle s’évanouit dans les ténèbres, jusqu’à disparaître complètement.
Alors je me suis mis à gémir. Gémir et même glapir ou japper comme un chien battu. J’ai pris ma tête entre mes mains et à la nuit déjà profonde et sans fin de toutes mes tripes j’ai hurlé : Mon dieu ! Mais qui fais-je venir au monde ?
Kontcha-Ozerna ‒ Kiev, 1993. Titre original en ukrainien : Жінка Змія (Jinka Zmiya) publié dans le recueil éponyme en 1998.